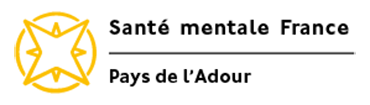La catastrophe annoncée n’a pas eu lieu. Alors que les plus pessimistes, aux premiers jours du confinement instauré pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, prévoyaient une prise en charge ingérable des malades psychiatriques, la mobilisation des professionnels a permis de limiter les dégâts. De fait, les établissements psychiatriques ont réorganisé leurs services et le circuit des admissions de telle sorte que l’épidémie de Covid est restée contrôlable, et aucun « tri de patients » n’a été nécessaire pour cause d’indisponibilité de lits. Mais le pire reste sans doute à venir.
Ruptures de soins durant le confinement (10 % des malades auraient été perdus de vue), isolement social accru, discours alarmiste sur la crise sociale à venir : l’effet boomerang que redoutent les professionnels de santé commence déjà à se faire sentir.
En Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, les patients affluent aux urgences psychiatriques. Dans le département de Seine-Saint-Denis, sous tension maximale, les lits manquent pour hospitaliser des malades en grande demande. « De la souffrance psychique est née dans la population confinée et les besoins de soins ont globalement augmenté », constate le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, Franck Bellivier. Et de nouveaux patients sans antécédents psychiatriques pourraient se présenter à la rentrée, souffrant en contrecoup de stress post-traumatique ou d’épisodes dépressifs. De quoi aggraver encore la souffrance de la psychiatrie française, grande malade de la santé publique en France.
Cacophonie
Les symptômes, graves et multiples, font à peu près l’unanimité : tandis que la demande des patients explose, l’offre dysfonctionne – diagnostics beaucoup trop tardifs, suivi des soins chaotique, financements notoirement insuffisants. Mais dès qu’on aborde les causes du mal qui affecte ce secteur d’un hôpital public lui-même sous perfusion, et plus encore le traitement qu’il conviendrait de lui appliquer, c’est la cacophonie. Pour ne pas dire la guerre.
Deux ouvrages récents, à eux seuls, résument le clivage existant entre certains courants de la profession. Le premier, Psychiatrie : l’état d’urgence (Fayard, 2018), émane de deux professeurs de psychiatrie universitaires, Marion Leboyer et Pierre-Michel Llorca, respectivement directrice et directeur des soins de FondaMental : une fondation de « coopération scientifique » créée en 2007 pour lutter contre les maladies mentales qui met l’accent sur la recherche, le diagnostic et la prévention des troubles. Coédité par le think-tank libéral Institut Montaigne, le livre formule 25 propositions pour sortir la psychiatrie de la crise. Notamment la mise en place d’une agence nationale de la santé mentale, sur le modèle de ce qui a été fait avec la création, en 2004, de l’Institut national du cancer.
Le second ouvrage, La Révolte de la psychiatrie (La Découverte, 240 p., 19 €), paru en début d’année, est signé par Mathieu Bellahsen, psychiatre et membre actif du mouvement Printemps de la psychiatrie, et Rachel Knaebel, journaliste pour le site d’information Bastamag. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il interroge les maux et l’avenir de la psychiatrie sous un prisme radicalement différent de celui de FondaMental. Quand la fondation parle diagnostic, avancées biomédicales et réorganisation des soins, ces deux auteurs mettent en avant la tolérance aux plus fragiles, la relation soignant-soigné, la trop grande importance prise selon eux par les sciences du cerveau. Ils reviennent sur les mouvements de contestation qui ont secoué plusieurs hôpitaux psychiatriques en 2018 et 2019 et fustigent les méthodes managériales qui dirigent désormais le système hospitalier. Entre ces deux visions que tout oppose, la psychiatrie tente de survivre. Et de définir son évolution à venir.
Une occasion « historique »
Elle y est d’autant plus encouragée que le pouvoir politique, après des années d’atermoiements, semble enfin s’y intéresser. En 2017, la ministre de la santé Marisol Touraine crée un comité de pilotage de la psychiatrie. En 2018, le Comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie (CSSMP) produit une feuille de route en 36 points. Début 2019, la ministre Agnès Buzyn promet 40 millions d’euros pour financer ce plan, ainsi que le renforcement des moyens humains, notamment pour la pédopsychiatrie. Pour le psychiatre Pierre Thomas, professeur à l’université de Lille et coprésident du comité de pilotage de la psychiatrie, il y a là une occasion « historique » de changer radicalement le paysage de la discipline. Et à l’entendre, « il y a lieu d’être optimiste », car « la fenêtre de tir qui est en train de s’ouvrir pour la psychiatrie ne s’est tout simplement jamais produite ».
En France, son acte fondateur se situe en 1838, date à laquelle la loi instaure la création, dans chaque département, d’établissements spécialement destinés à accueillir et soigner les aliénés. Leurs occupants devant être tenus à l’écart du monde, la plupart de ces asiles sont construits en dehors des villes. « Pour ces raisons historiques, la prise en charge des troubles mentaux a longtemps été éloignée des facultés de médecine, rappelle Pierre Thomas. Il a fallu attendre 1937 pour que la terminologie officielle remplace les “asiles d’aliénés” par des “hôpitaux psychiatriques”, et pour que ces derniers passent de la tutelle du ministère de l’intérieur à celle du ministère de la santé. La psychiatrie est certes une branche de la médecine, mais elle s’est toujours tenue à distance des autres disciplines. »
Les médecins de l’âme
A cette singularité est venue dans les années 1960-1970 s’en ajouter une autre, dont les effets se font lourdement sentir aujourd’hui : la sectorisation. Au sortir de l’Occupation, le choc causé par la découverte de 40 000 patients morts de faim ou de froid au sein des asiles psychiatriques avait amené à rompre avec le modèle fondé sur l’isolement. De ce mouvement « désaliéniste » naquit tout d’abord le développement de la psychothérapie institutionnelle, axée sur la dynamique de groupe et la relation entre soignants et soignés. Puis le découpage de la psychiatrie publique en « secteurs » d’environ 70 000 habitants, gérés par un hôpital de référence mais dotés d’une offre extrahospitalière afin de permettre à chacun de venir consulter au cœur des villes. Cette avancée historique permit de développer sur tout le territoire un suivi hors les murs et de systématiser le lien entre soins et prise en charge sociale.
Pour les médecins de l’âme, l’époque était d’autant plus enthousiasmante que les premiers neuroleptiques venaient d’être découverts, qui permettaient de réduire les symptômes des patients et de les laisser sortir plus facilement. La psychanalyse, elle aussi, semblait alors prometteuse pour traiter les troubles mentaux. Un alignement de planètes comme la psychiatrie n’en avait jamais connu, qui a laissé dans l’esprit de la génération de soignants formée à cette époque une nostalgie durable.
Car l’âge d’or fut de courte durée. Tandis que s’affirmait en parallèle une psychiatrie hospitalo-universitaire plus ou moins désectorisée, la psychiatrie de secteur, dont dépendent les hôpitaux psychiatriques, se révéla au fil du temps de moins en moins opérante. Par manque de moyens, assurément. Mais aussi de par sa genèse même. « La sectorisation s’est déployée avec les moyens et l’esprit qui étaient auparavant ceux de l’hôpital, souligne Pierre Thomas. Psychiatres et soignants ont été exportés dans la ville afin d’y assurer la continuité du suivi. Mais une fois hors des murs de l’hôpital, un patient souffrant de troubles psychiques doit aussi pouvoir se loger, trouver du travail, avoir une vie sociale. Et les personnes les plus pertinentes pour l’y aider ne sont pas les médecins et les infirmiers. »
Un labyrinthe illisible de structures et d’acteurs
Ce sont notamment les professionnels du secteur médico-social, vaste et complexe domaine qui entretient avec le monde de la psychiatrie des relations tendues, chacun craignant que les financements aillent prioritairement à l’autre. Au fil des années, le système est ainsi devenu un labyrinthe illisible de structures et d’acteurs. Avec pour conséquence, comme le relevait en septembre 2019 le rapport sur la psychiatrie française des députées Martine Wonner (LRM, Bas-Rhin) et Caroline Fiat (LFI, Meurthe-et-Moselle), une organisation territoriale de la santé mentale « tout à la fois inefficiente et inefficace » et « une incompréhension totale du dispositif de la part des patients et de leur famille ».
Pour sortir de cette crise majeure, c’est donc toute la réorganisation des soins qu’il faut repenser. En tenant compte de la parole des patients et de leur famille, qui demandent désormais à participer au processus de décisions qui les concernent. En tenant compte, aussi, des frustrations d’une nouvelle génération de psychiatres, qui réclame une meilleure formation et une plus grande implication dans les processus décisionnels. C’est dans ce contexte historiquement marqué qu’il faut entendre les tensions idéologiques et politiques qui travaillent le monde de la psychiatrie. Et analyser l’inquiétude à laquelle a donné lieu, ces dernières années, la montée en puissance de FondaMental.
Comme le précise la page d’accueil de son site Internet, cette fondation travaille « sur les pathologies considérées comme les plus invalidantes : la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle, les pathologies résistantes (dépression et troubles obsessionnels compulsifs), les conduites suicidaires et le stress post-traumatique ». Présidée par David de Rothschild et financée pour une bonne part par des fonds privés, elle a notamment développé un réseau de plus de 40 centres dits « experts », consacrés au diagnostic de ces troubles mentaux et hébergés par des centres hospitaliers universitaires (CHU) ou des hôpitaux publics.
L’insuffisance du dépistage précoce
Concrètement, ces centres reçoivent des patients – souvent des cas complexes – envoyés par leur médecin généraliste ou leur psychiatre. Un bilan complet leur est proposé, qui permet de définir un programme thérapeutique personnalisé (médicaments, psychothérapies, hygiène de vie) adressé au médecin traitant. La fondation, qui ne propose donc pas de suivi de soins à proprement parler, vise par ailleurs à « identifier des marqueurs biologiques » qui permettront, espère-t-elle, de mieux caractériser les maladies et d’ajuster leur prise en charge. Elle propose donc aux patients qu’elle reçoit d’être intégrés dans une base de données pour leurs recherches, notamment génétiques.
Quel mal à cela ? Toute la profession s’accordant sur l’insuffisance du dépistage précoce des troubles mentaux, l’utilité de ces centres « experts » paraît évidente. De même, aucun médecin ne niera l’importance de la recherche dans la compréhension et le traitement des maladies. Mais la maladie mentale, au carrefour du corps et de l’esprit, du normal et du pathologique, de la biologie et des sciences humaines, ne se laisse pas dompter si facilement par les neurosciences et la génétique. Malgré son puissant pouvoir dans la plupart des disciplines médicales, la biologie ne parvient guère à expliquer et soulager les grandes souffrances psychiques – si ce n’est en les réprimant à l’aide de psychotropes. S’il est un domaine où les actes techniques et médicaux ne parviennent pas à prendre le pas sur une approche globale et humaniste, c’est bien la psychiatrie. Car celle-ci ne cherche pas à soigner des organes – fût-il le plus sophistiqué de tous, le cerveau – mais un sujet.
Une réalité que les dirigeants de FondaMental ne nient pas, mais qui n’est pas leur priorité. « Il y a fort à parier que les diagnostics de demain ne reposeront plus sur des critères subjectifs, rétrospectifs et qualificatifs, mais sur des évaluations objectives, écologiques et quantitatives, grâce au déploiement d’outils de mesure en temps réel », développent Marion Leboyer et Pierre-Michel Llorca dans Psychiatrie : l’état d’urgence. Une approche très scientifique qui a le don de hérisser les tenants d’une psychiatrie plus relationnelle. « Pour prévenir et soigner les troubles psychiatriques, FondaMental regarde du côté de la neurologie, de la biologie, de la génétique, de l’imagerie cérébrale et, évidemment, des prises en charge médicamenteuses. Soit une vision de la maladie mentale centrée sur les causes organiques, biologiques, beaucoup moins encline à s’intéresser au rôle de la relation entre patients et soignants », résume Mathieu Bellahsen dans La Révolte de la psychiatrie.
Une approche plurielle
« C’est vrai, on fait des recherches qui ont à voir avec la biologie, la génétique et le cerveau. Mais quand on voit des patients, on ne soigne pas des cellules ou des neurones ! », rétorque Pierre-Michel Llorca. Ceux qui nous reprochent de prôner une psychiatrie biologique ne savent rien de nos a priori théoriques : pour beaucoup, faire des neurosciences signifie forcément détester la psychanalyse… Cela n’a aucun sens ! »
« Ce que fait cette fondation est très bien, mais elle suscite de l’envie : elle a beaucoup d’argent, une vraie force de communication, et cela peut masquer des initiatives qui existent par ailleurs », résume prudemment le psychiatre Pierre Thomas. De l’envie, mais aussi une vraie inquiétude. Celle de voir la discipline basculer du côté biomédical et surspécialisé, au détriment d’une approche « plurielle » des souffrances psychiques, qui en chercherait le sens à l’articulation des points de vue sociaux, biologiques, psychologiques et familiaux. Une crainte d’autant plus forte que ce discours capte volontiers l’oreille des politiques… et des médias.
Rappelant, dans un article récemment paru dans la prestigieuse revue The New England Journal of Medicine, que neurosciences et génétique sont encore loin d’apporter une aide réelle à la psychiatrie clinique, deux médecins de l’université de Harvard pointent ainsi le double discours qui existe en la matière. « Bien que ces limitations soient largement reconnues, écrivent-ils, le message qui prévaut pour le grand public et le reste de la médecine est encore que la solution aux problèmes psychologiques consiste à faire correspondre le “bon” diagnostic au “bon” médicament. »
Or, cette conviction « neuro-essentialiste », affirme le neurobiologiste François Gonon, a des effets néfastes : selon lui, elle exacerbe chez les tiers le rejet des patients, diminue l’empathie des soignants, augmente le pessimisme des malades eux-mêmes sur leurs chances de guérison et focalise leurs attentes sur les médicaments psychotropes. Enfin, elle n’est pas sans conséquences sur la société en général, puisque ce discours « discrédite par avance les mesures sociales qui permettraient de diminuer la prévalence de ces troubles, en particulier la lutte contre les inégalités socio-économiques ».
Le nombre de personnes en souffrance augmente
« Je ne conteste pas l’existence de facteurs organiques dans les souffrances psychiques et sociales. Mais celles-ci nous mettent face à quelque chose qui ne peut pas être simplement réductible à un dérèglement de la machine organique, fût-elle neuronale », renchérit Roland Gori, psychanalyste et professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique à l’université Aix-Marseille. Pour ce fin observateur des logiques de normalisation, auteur avec Marie-José Del Volgo d’Exilés de l’intime. Vers un homme neuroéconomique ? (2008, republié en poche en avril 2020 aux Liens qui libèrent), « il y a une bonne raison de privilégier cette idéologisation scientiste et de capter nos souffrances psychiques pour les transformer en diagnostic : cela disculpe la société de la part qui est la sienne dans la fabrique des symptômes ». Le risque étant, selon lui, de nous entraîner progressivement dans une « pharmacovigilance des comportements ».
Diagnostics trop tardifs, prévention et interventions précoces insuffisantes, ruptures dans les parcours de soins, recours excessif à l’hospitalisation sous contrainte, retour à la vie sociale et professionnelle aléatoire : au-delà des querelles d’idées, et tandis que le nombre de personnes en souffrance ne cesse d’augmenter, la psychiatrie française attend toujours d’être soignée.