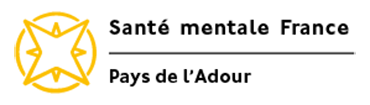Dans Le Monde (25 mars 2020) : le désarroi des hôpitaux psychiatriques face au coronavirus
Pas de masques, nulle part ou presque. Pas même au Groupe hospitalier universitaire (GHU) psychiatrie et neurosciences de Paris, qui regroupe les hôpitaux Sainte-Anne, Maison-Blanche et Perray-Vaucluse – soit 70 000 patients par an et un millier de lits. « Dans la distribution, nous avons tout simplement été oubliés par les autorités sanitaires, constate le docteur Raphaël Gaillard, chef de pôle à l’hôpital Sainte-Anne. Comme si la psychiatrie était une spécialité accessoire, un luxe que l’on peut se permettre en temps de paix. » Dans le secteur de la santé mentale, parent pauvre d’un système hospitalier lui-même dégradé, la crise sanitaire actuelle suscite les pires inquiétudes. Pour les soignants, et plus encore pour les malades.
Partout, que ce soit dans les services de psychiatrie des hôpitaux généraux ou dans les établissements psychiatriques de secteur, le confinement en vigueur depuis le 17 mars entraîne les mêmes réorganisations. Avec deux objectifs : éviter au maximum le rapprochement des personnes et libérer des lits. La sortie des patients dont l’état est jugé satisfaisant est accélérée, la plupart des consultations reportées ou effectuées par téléphone. « J’avais entre 70 et 100 patients à voir dans les trois prochaines semaines, j’ai demandé à seulement deux d’entre eux de venir », précise Matthieu Gasnier, du service de psychiatrie de l’Hôtel-Dieu (Paris). On s’adapte dans l’urgence. Et non, parfois, sans une certaine amertume.
« Une médecine humanitaire, en plus difficile »
Janine Carrasco travaille à l’hôpital psychiatrique Etienne-Gourmelen, à Quimper (Finistère). Si le centre médico-psychologique (CMP) y est resté ouvert, les structures ambulatoires, elles, ont fermé. Dans cet important établissement (1 000 salariés, 250 lits), une partie des personnels a été réaffectée pour renforcer les structures d’accueil des patients atteints du Covid-19. « En prévision de l’absentéisme des collègues qui vont tomber malades, ils ont déjà fermé les structures de jour qui assurent les urgences. De nombreuses personnes ne seront plus soignées. Une fois de plus, c’est la psychiatrie qui doit diminuer la voilure », déplore cette éducatrice spécialisée.
Familière des missions de Médecins sans frontières, avec qui elle a longtemps travaillé, la pédopsychiatre Marie Rose Moro, qui dirige la maison des adolescents de l’hôpital Cochin, à Paris, évoque quant à elle « une médecine humanitaire, en plus difficile, car [ils n’ont] jamais connu ça ici ». En quelques jours, tout a dû être réorganisé : plus de visites des parents et des enseignants, activités de groupe réduites à l’extrême, mesures d’hygiène draconiennes. « On recentre tout sur l’essentiel pour pouvoir soigner ceux qui vont le plus mal. »
Globalement, la vingtaine d’adolescents hospitalisés dans cet établissement réagissent plutôt bien au confinement et à la réduction des visites. « Ils comprennent ce qui se passe, et le fait d’avoir des consignes claires – se tenir à un mètre les uns des autres, ne pas se toucher – les aide à contrôler leurs angoisses internes. Mais cela peut aussi précipiter leur décompensation. Il y a quelques jours, deux jeunes se sont mis à délirer. »
« Montée des tensions et de l’angoisse »
Comprendre ce qui se passe : un luxe que tous les malades psychiatriques ne peuvent pas s’offrir. Sarah Iribarnegaray, psychiatre à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, à Paris, travaille dans l’unité des patients difficiles. « Pour beaucoup d’entre eux, délirants ou très déprimés, l’épidémie est très loin de leurs préoccupations. Ce qui les touche directement, c’est l’absence de visites et la suppression des permissions de sortie », relate-t-elle.
« Pour les patients les plus fragiles ou les plus difficiles, le confinement risque, sur la durée, de faire monter les tensions et l’angoisse », renchérit Marie-Victoire Ducasse. A l’hôpital Sainte-Anne où exerce cette jeune psychiatre, les malades mangent désormais en chambre et non plus dans la salle commune. L’accès au parc est fermé. La salle de télé, en revanche, est restée accessible. « Certains patients comprennent qu’il faut faire respecter les gestes barrières, mais pour ceux qui sont très désorganisés, c’est compliqué, reconnaît-elle. On ne va pas non plus les enfermer 24 heures sur 24 dans leur chambre, ça n’a aucun sens. »
Pour la plupart des psychiatres, les bouleversements qu’entraîne la gestion de l’épidémie laissent craindre deux types de risques. Le premier concerne le suivi et la qualité des soins, critère particulièrement essentiel pour ces populations au psychisme fragilisé. « Les consultations par téléphone, pour le moment, se passent plutôt bien, constate Raphaël Gaillard. Mais pour combien de temps ? L’expérience que nous avons tirée de l’explosion de l’usine AZF, à Toulouse, en 2001, qui avait soufflé un hôpital psychiatrique situé juste à côté, c’est que, dans les situations aiguës, nos patients se comportent plutôt de façon remarquable. Mais il y a forcément un effet rebond. »
« Un afflux de patients »
Déjà, la tension se fait sentir pour certains d’entre eux. « Toutes les structures extra-hospitalières ferment, et nous assistons à un afflux de patients isolés, qui pètent les plombs. Les schizophrènes paranoïdes notamment, qui ont tendance à se sentir persécutés », constate Delphine Rousseau, psychologue à l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard (Bondy, Seine-Saint-Denis) et dans le service addictologie du Centre hospitalier intercommunal André-Grégoire de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Privés de leurs recours habituels, les plus vulnérables, ceux qui sont à la rue ou zonent de place en place, risquent fort d’atterrir aux urgences psychiatriques.
Deuxième crainte grandissante des psychiatres : la propagation du coronavirus au sein d’un établissement. Aucun foyer de contamination n’a pour le moment été déclaré, mais la perspective est plausible, et très inquiétante. « On sait que certains malades voient leurs familles et que les familles véhiculent le virus. Nous allons avoir des malades Covid +, et il sera particulièrement difficile de les prendre en charge, prévoit le docteur Norbert Skurnik, psychiatre hospitalier et président du comité d’éthique du GHU de Paris, qui rappelle que, « lorsqu’un schizophrène délirant a un infarctus, c’est déjà l’abomination pour trouver des soins ».
Que fera-t-on de ces malades contagieux, s’ils sont en détresse vitale ? Il n’y a pas de service de réanimation dans les hôpitaux psychiatriques. « On est en train de chercher des solutions un peu partout. Mais on n’a aucune directive, aucune consigne claire, se désole le docteur Skurnik. C’est le far west. »
Catherine VINCENT
© 
Publié le 25 mars 2020 à 13:55